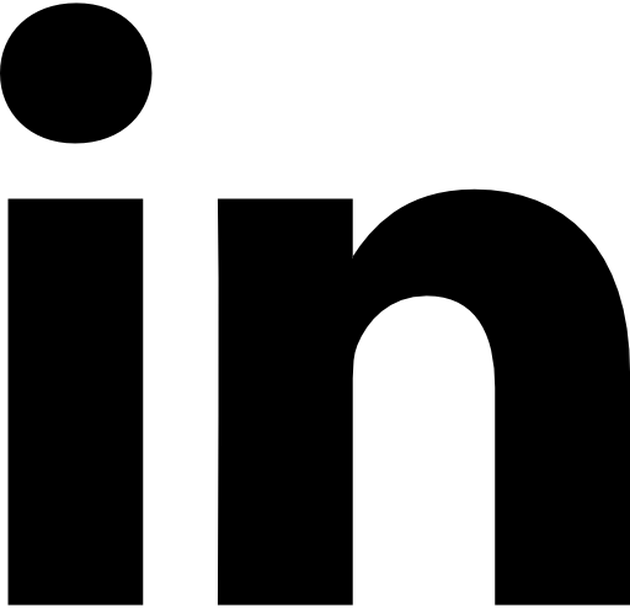Le Good, nouvelle façon de se penser

Si une vidéo est présente au sein de cette publication, celle-ci ne sera lisible qu'après acceptation des cookies déposés par notre partenaire YouTube.
Article librement inspiré du webinaire « Le Good, pilier d’un monde nouveau ? » animé le 27 août par Elisabeth Laville, fondatrice de l’agence Utopies, Mariette Darrigrand, sémiologue et dirigeante du cabinet Des Faits et Signes, et Christelle Leroy, directrice RSE du groupe TF1, dans un échange organisé par le magazine Influencia.
Galvaudé, le Good ? Pour de vrai, ou pour le dire ? Celui qui a envahi les briefs que nous recevons concentre beaucoup des espoirs d’un (re)nouveau fertile et durable, une tentative d’ancrage dans un projet certain qui rassure face à un avenir qui l’est moins. Entre arrivée à maturité des stratégies RSE et uniformisation du discours vertueux, le Good cherche un nouveau souffle pour résonner dans son époque et avec l’ADN des marques.
Le Good, une idéologie à contextualiser
_ « Définir le Good, c’est avant tout
se mettre d’accord sur ce qui est ‘bien’. »
Le Good n’est pas nouveau. Derrière ce mot – que nous peinons à traduire en français, juxtaposant systématiquement bon et bien pour la justesse – se trouve la notion de mise au premier plan du bien commun. Une tendance idéologique qui remonte à l’Antiquité, et qui cherche un épanouissement individuel dans le respect de ce qui est à tous : la santé des humains, des autres espèces, de la planète. C’est là qu’est née la notion d’éthique, de morale : des éléments qui se définissent autant dans la question qu’ils posent, que dans le contexte de la réponse. Les valeurs éthiques de l’Antiquité ne sont plus celles d’aujourd’hui.
Ce que le Good d’aujourd’hui vient bouleverser, c’est l’idéologie développée dans les années 70 qui place la liberté individuelle à jouir librement sans entrave, qui a contribué au développement de la société de consommation, et qui a pris la place de tout : le bien commun entre les humains, économique et écologique. Ce qui est souverain bien (la « fin en soi » des humains à un moment donné),c’est la liberté de chacun. Ce n’est qu’en 1987 qu’émerge une autre forme de souverain bien, autre que cette liberté individuelle à jouir, lors du sommet de l’ONU avec la publication « Our Common Future », rédigée par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations unies, présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland. La notion moderne de Sustainability est née. Elle connaît aujourd’hui un pic idéologique, encouragé par la crise et la prise de conscience que l’impossible n’est pas loin, dans ce que nous pouvons subir mais également accomplir. Entre impératifs de croissance dictés par l’économie capitaliste et démarche de durabilité exigée par les consommateurs, les marques en désir de satisfaire les deux partis peinent à communiquer sur le sujet. D’après ces expertes, quelques clés permettent de s’approprier l’enjeu et de conserver de la singularité, clé de l’émergence en communication.
Des paroles et des actes
_ « Limiter les impacts RSE ne suffit plus,
il faut que les entreprises contribuent à la résolution des problèmes. »
Les stratégies RSE entamées pour beaucoup d’entreprises depuis plusieurs années (15 ans pour TF1 et la création de la Direction RSE) arrivent aujourd’hui à maturité dans leur définition première : la limitation de l’impact écologique et sociétal de l’activité des entreprises, dans leur production de biens et de services. Désormais, il est attendu des entreprises qu’elles contribuent à la résolution des problèmes, et pas seulement à limiter la casse. Ces engagements doivent se situer au cœur du business et non à côté, au travers d’un engagement caritatif par exemple. Cette interdépendance de l’économie et du bien commun questionne le tissu même de notre société en cherchant à faire cohabiter des notions jusqu’alors antagonistes : la reprise de l’économie et le mieux-aller de la nature. A l’image du recyclage, où le pictogramme de la contribution aux investissements de recherche ne suffit plus, et auquel nous préférons le logotype qui indique que l’emballage est recyclable.

1 
2
2.: Ruban de Möbius identifiant un produit potentiellement recyclable.
Les consommateurs n’attendent plus des entreprises qu’elles proposent une gamme verte, ou que leurs engagements ne concernent qu’un pourcentage de leur activité. Pourtant, ces processus sont longs, et les annonceurs sont face à un dilemme : parler avant d’être parfaits, prendre le risque d’être taxé de goodwashing(les paroles sans les actes) ou se taire et pâtir du silence, au risque de disparaître des esprits par déconnexion avec les enjeux actuels ? La question fait débat. Le goodwashing peut présenter un intérêt pour le bien commun : les mots engagent les entreprises et poussent ces dernières à transformer leurs intentions en actes concrets. Lorsque les choses sont dites sur la place publique, elles ne peuvent être reprises. Des professions de foi risquées, mais qui peuvent payer, à condition de faire preuve de transparence et d’honnêteté auprès des consommateurs vis-à-vis du chemin parcouru et de celui qui reste à parcourir.
Une autre voie s’est dessinée pendant la crise sanitaire du Covid-19, celle d’une communication de crise qui a répondu à l’urgence des besoins par l’urgence des actes, en lien avec les postures de marque. La MAIF, qui communique depuis plusieurs années sur sa raison d’être, a durant la crise, choisi en accord avec son identité mutualiste de rembourser les bénéfices perçus via l’assurance auto à ses sociétaires, les voitures stationnées pendant le confinement ne créant ou ne subissant pas d’accidents de la route. Une communication par les actes qui a eu un impact très positif sur l’image de la marque, car elle a su allier la posture du groupe assurantiel à sa réaction dans une situation d’urgence. Une action décidée à court terme, avec une rentabilité sur le long terme. Nike, dont les cycles de productions et de mise sur le marché d’un nouveau produit avoisinent habituellement les 18 mois, a mis à disposition des visières créées à partir de matériaux présents dans leurs usines en deux semaines. Pour des structures de taille plus modeste telle que des start-ups encore jeunes, les bénéfices d’une relation de confiance de long terme avec leurs fournisseurs, partenaires et consommateurs se constatent également : dans une tourmente, les réseaux qu’elles créent autour d’elles sont plus enclins à se mobiliser pour les aider à faire face à une situation difficile, loin d’un individualisme business présumé. La résilience se travaille aussi au travers du collectif. Les individus eux-mêmes se sont mobilisés pour permettre à leurs commerces de proximité de survivre : des cagnottes ont été créées pour permettre à leur bar, leur restaurant favori de subsister. Les actions les plus fortes ont été visibles, concrètes, localement perceptibles. Ce que cette crise a accentué, c’est l’évidence sous-jacente à la raison d’être que celle-ci n’est rien sans raison d’agir – et surtout sans actions, et avec elle la nécessité continue de dire ce que l’on fait, mais aussi de faire ce que l’on dit. Nike se retrouve ainsi sous le feu des projecteurs dans une lumière moins flatteuse, lorsque des comptes lui sont demandés (comme à tant d’autres) vis-à-vis de leurs partenariats de production avec des fournisseurs chinois soupçonnés d’exploiter la population Ouïghour. Il faut être irréprochable, partout, ou tout s’écroule.
Retrouver de la singularité dans la communication
_ « Le monde d’après se construit avec ce que je fais dans l’heure qui vient. »
Lorsque la FING (Fondation Internet Nouvelle Génération) a édité en 2015 son « Agenda pour un futur numérique et écologique », elle a énoncé ce postulat : toute transition est guidée par une destination et un chemin ; si la transition numérique connaissait son chemin mais pas sa destination, la transition écologique connait sa destination mais pas son chemin. Un indice qui permet de lever le bout du voile sur l’impact des enjeux de la RSE, de la raison d’être et du purpose dans la communication : la création d’un méta-discours qui, faute de chemins, galvaude l’idéologie du Good en tant que moteur d’un nouvel écosystème économique et humain en le réduisant à sa seule destination. A n’être qu’idéologie et lisser les aspérités des divergences qu’elle aurait pu accueillir en son sein, le discours devient doxa.
Il appartient alors à chaque marque de trouver son point de vue sur le chemin, qui porte son regard sur l’idéologie du good : construire autour de son discours de preuves sa position et sa posture, en résonance avec ce qui l’ancre dans son sol. En partant de soi et de ce qu’on peut changer, les idéaux deviennent des combats sincères qui après s’être appliqués à l’entreprise, permettent à la marque de porter avec légitimité un discours auprès d’une vision d’une société meilleure. Puis, afin de ne pas laisser les mots éroder les idées, les marques doivent travailler main dans la main avec leurs agences pour se distancier des mots codes de l’idéologie, pour aller vers l’invention d’un vocabulaire qui leur sera propre. Cette singularité du discours qui porte loin la voix des actes est l’outil indispensable de la distinction, et de l’efficacité auprès de consommateurs toujours plus suspicieux.
_ « Celui qui veut réussir trouve un moyen,
Celui qui ne veut pas, une excuse. »

Sarah Scherrer
Head of Planning – Leo Burnett